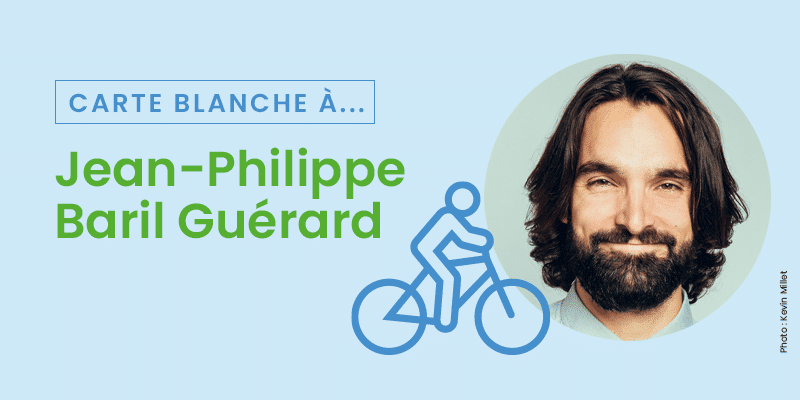On voit peu de vélos, dans les récits post-apocalyptiques.
Je suis fan du genre depuis que j’ai vu 28 Days Later alors que j’étais préado. Dans ce cas-là, l’absence de vélo s’explique bien : 28 jours après une pandémie mondiale qui transforme tout le monde en zombies, c’est crédible qu’on garde les mêmes réflexes de transport, et qu’on tente de s’enfuir d’un Londres infesté de monstres en taxi noir. (Ironiquement, c’est un accident de vélo qui est l’élément déclencheur du film : le personnage principal, coursier, est victime d’un accident qui le plonge dans un coma duquel il se réveille après les 28 jours du titre.)
Mais dans une œuvre comme The Last of Us, qui se passe 20 ans après un événement semblable, ça me semble étonnamment contre-productif que les personnages y soient encore enchaînés à la voiture, d’autant que l’essence a la fâcheuse tendance de perdre sa combustibilité après quelques mois. L’univers de Mad Max est encore plus surprenant sur ce point : dans un monde où la civilisation s’est écroulée à cause de guerres de pétrole, les personnages traversent le désert… en brûlant du gaz dans leurs muscle cars.
Je m’enfarge dans les fleurs du tapis, évidemment : si je suspends mon incrédulité pour croire à l’effondrement du monde tel que dépeint dans une histoire comme The Road, je devrais aussi pouvoir m’imaginer un monde magique dans lequel l’essence ne se tarit jamais et reste toujours fraîche. Mais ça me semblerait plus crédible, dramatiquement, thématiquement, que les personnages y passent plus de temps à vélo.
C’est que de manière consciente ou non, la presque totalité de ces récits post-apocalyptiques mettent de l’avant une vision très conservatrice du monde : on y célèbre l’individualité, la débrouillardise, la primauté des liens familiaux et de la tribu immédiate, alors qu’on expose la fragilité d’un état centralisé et le danger que posent l’Autre et l’Inconnu. Il me semble qu’il existe peu d’innovations technologiques aussi bien adaptées à cette vision du monde que celle du vélo. Le vélo ne dépend pas d’un service centralisé, comme le téléphone cellulaire, ou d’une chaîne d’approvisionnement, comme la voiture. Sa mécanique, malgré quelques changements, a résisté à la sur-sophistication (et l’obsolescence planifiée) qu’on a observée chez beaucoup trop d’objets de notre quotidien. Apprenez quelques notions de base en mécanique, et vous êtes soudain aussi libre, autonome, indépendant et puissamment viril que Brad Pitt dans World War Z.
Et pourtant, une simple revue de presse des médias québécois porte à croire que les vélos jouissent du droit de vote, qu’ils exercent, en bloc, en faveur du Parti communiste, et qu’ils passent tous leurs temps libres à crever des pneus de char. Le vélo, si on se fie aux critiques les plus véhémentes, c’est l’affaire des anticapitalistes et des écofascistes.
Ce n’est pas que la pratique du vélo ne peut pas, ou ne doit pas, être un acte politique. Au contraire. Mais son potentiel politique me semble tragiquement sous-utilisé, particulièrement par la droite. Les partis et les organisations qui se soucient de la réduction des dépenses de l’État auraient tout intérêt à comparer les analyses coûts-bénéfices de projets d’élargissement de boulevards à ceux d’ajouts de voies pour le transport actif. La « mode » de la densification, idéale pour le transport actif mais tournée en dérision par l’ex-ministre des Transports François Bonnardel, a pourtant tout pour séduire un gouvernement économiquement conservateur : elle permet une utilisation plus efficace des ressources financières des différents paliers de gouvernement. Sans compter qu’on sait tous qu’un gouvernement qui veut réduire sa facture en frais de santé — le poste le plus coûteux de l’État — a tout intérêt à prévenir plutôt que guérir… et que l’activité physique quotidienne est un énorme déterminant de la santé globale.
Mais le vélo n’a pas à être un acte politique. Le dernier sondage quinquennal sur la pratique du vélo au Québec, commandé par Vélo Québec, publié en 2021, concluait que 54% des Québécois avaient roulé au moins une fois dans l’année précédente. Ça fait beaucoup de citoyens qui peuvent s’entendre sur au moins un point : rouler, c’est le fun. Si on ne veut pas parler politique, on aura toujours ce point sur lequel se rabattre.
Ma famille en est un bon exemple : on sait qu’il vaut mieux éviter de parler politique, parce qu’on a souvent des positions divergentes. Aussi divergentes que nos pratiques du vélo, en fait : nos parents nous ont tous légué, mes quatre sœurs et moi, leur amour du deux-roues, qu’on a embrassé chacun de manière différente, en pratiquant le vélo utilitaire, de montagne, ou le triathlon. On se rejoint sur deux roues, que cette roue soit habillée d’une pneu clouté, à crampons, ou lisse. On arrive à s’entendre sur le fait que ça nous rend heureux, et que tout le monde a intérêt, comme nous, à passer le maximum de temps en selle.
On a tout intérêt, collectivement, à voir le vélo comme un espace où trouver un terrain d’entente. Ça pourrait nous éviter de glisser vers le premier scénario post-apocalyptique où on verrait des personnages utiliser des vélos pour assurer leur survie.